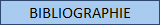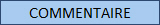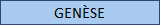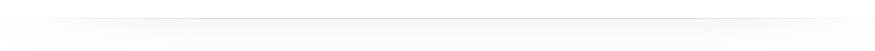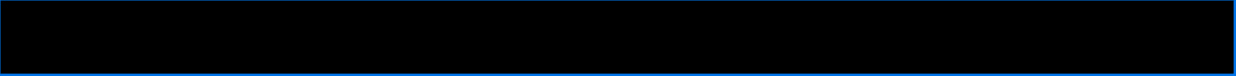Vents, de tous les souffles
________________________________________________________________________________________________________
Toute reproduction du contenu du site est libre de droit (sauf en cas d'utilisation commerciale, sans autorisation préalable), à condition d'en indiquer clairement la provenance : url de la page citée, indication de l'auteur du texte.
© 2014 Saint-John Perse, le poète aux masques (Sjperse.org / La nouvelle anabase). Site conçu, écrit et réalisé par Loïc Céry.
Même si Claudel reconnaît que l’absence de Dieu dans l’horizon persien l’éloigne radicalement de son éthique spirituelle (où le maître de Brangues se souvient peut-être d’une tentative de conversion demeurée infructueuse auprès du jeune Leger, quarante ans auparavant), le dialogue initié là entre deux poètes qui s’admirent et se respectent, donne le « la » de cette réception d’une œuvre considérée comme essentielle par son auteur lui-même, parce qu’il y a mis beaucoup de sa pensée, parce qu’elle est issue d’une poétique comme tendue à ses extrêmes. Une quintessence de la poétique persienne se joue dans Vents, que la création du poème a reflété.
« Non point l’écrit, mais la chose même. Prise en son vif et dans son tout »
Vents est publié chez Gallimard en 1946, dans une édition luxueuse limitée à 2425 exemplaires. Bien plus tard, dans ses Œuvres complètes, voici ce qu’en dit le poète dans la notice qui se rapporte au poème (il est toujours important de se référer à ces textes, fondateurs de cette image contrôlée de l’œuvre que Perse voulut diffuser) :
« Saint-John Perse a toujours accordé à Vents une importance particulière dans son œuvre. Ce poème fut sans doute le moins accessible au lecteur français parce qu’il ne fut, à la demande même du poète, publié tout d’abord qu’en édition de luxe, de grand format et grande typographie, à tirage limité entièrement numéroté (Gallimard, 1946). »
Il est aisé, quand on est familier du style de ces notices du volume de la Pléiade, de déceler ici chez Perse comme une secrète délectation, dans cette manière d’attirer l’attention sur la faible diffusion française, volontaire de sa part : c’est peut-être marquer cet ancrage américain du poème, c’est en tout cas hisser son accès premier à quelques happy few qui parviendraient ici dans le saint des saints de l’œuvre, poème d’une « importance particulière ». On a appris, à juste titre, mais parfois avec excès, à se méfier des présentations livrées par le poète lui-même dans « sa » Pléiade ; pourtant, tout encourage à faire grand cas de cette sorte de primat accordé par Perse lui-même à ce poème, car à tout connaisseur de l’œuvre, Vents apparaît pour beaucoup comme une « somme » (ne parlons pas de sommet, pour ceux qui préféreront d’autres accents peut-être moins foisonnants au sein de l’œuvre), à la fois un maître-ouvrage et un roc intimidant. Roger Caillois ne s’y est pas trompé, quand il lui écrivit depuis New York, le 1er janvier 1947 :
« Je me réconforte ici en lisant de temps à autre quelques pages de Vents. C’est un véritable univers, votre monde total où affleurent les choses et les mots, les expressions et les tours de vos poèmes précédents. On les reconnaît, on les salue ; ils s’organisent et trouvent leur place ; chaque ligne en éveille une autre dans la mémoire qui vient d’Anabase ou d’Exil et qui lui répond comme un écho, comment dire : comme un écho qui la préparerait. Il me semble que vos autres poèmes son orchestrés dans celui-ci. »
Aussi, la réception première de l’œuvre doit-elle être elle aussi marquée d’excellence, et c’est certainement pourquoi Perse choisit, dans cette notice dévolue à Vents au sein de ses Œuvres complètes, de reproduire de larges extraits du texte essentiel que Claudel lui avait consacré dans la Revue de Paris, le 1er novembre 1949 : « Un poème de Saint-John Perse : Vents ». Avant les extraits, il mentionne cet enthousiasme de Claudel à propos de cette étude :
« J’ai pris connaissance, avec respect et admiration, de l’étonnante collection d’horizons, de perspectives immenses et peuplées, de Vents. La France a perdu un précieux conseiller, mais elle a conquis un très grand poète. » (20 février 1947)
« Je me sens devant votre œuvre comme devant quelque chose d’important et que l’on n’aborde pas à la légère ! Je l’ai empoignée pour de bon et j’essaye d’en prendre les dimensions. (…) Cher ami, vous êtes un grand poète. Je vous le dis, comme je le pense. Il faut que l’article très étudié que j’ai l’intention de vous consacrer – et qui peut-être ne vous donnera pas entière satisfaction – vous établisse en pleine lumière à votre rang. » (29 juin 1949)
« … Plus loin, plus haut, où vont les hommes minces sur leur selle ; plus loin, plus haut, où sont les bouches minces, lèvres closes.
La face en Ouest pour un long temps. Dans un très haut tumulte de terres en marche vers l’Ouest. Dans un déferlement sans fin de terres hautes à l’étale. »
« Ô vous que rafraîchit l’orage… Fraîcheur et gage de fraîcheur… » Le Narrateur monte aux remparts. Et le Vent avec lui. Comme un Shaman sous ses bracelets de fer :
Vêtu pour l’aspersion du sang nouveau – la lourde robe bleu de nuit, rubans de faille cramoisie, et la mante à longs plis à bout de doigts pesée. » (Vents, I, 2)
Le poème, terminé dans le décor de cette île sauvage et fière, est également imprégné de toute une intense fréquentation d’autres paysages américains marquants que découvre Perse lors de voyages entrepris en cette année 1945, et dont le poème gardera trace : au printemps, il visite l’Arizona, le Texas et le Colorado. On sait combien la découverte du Grand Canyon pour tout un chacun, voyageur ou américain natif, est souvent une expérience inoubliable. Perse est quant à lui littéralement fasciné par le gigantisme et la force des éléments géologiques qui se déploient sous ses yeux, et c’est avec frénésie qu’il y collecte les matériaux de son poème, comme en témoignent les archives conservées à la Fondation Saint-John Perse. Certes, le poème appelle des terres très lointaines, il institue un chant de la conquête humaine de l’espace, mais on peut effectivement y déceler tout un panorama de ces paysages américains que vit le poète avec ferveur : s’étendent des horizons à la mesure d’un souffle ample, et où l’appel à repousser les limites connues s’accorde au pas de l’homme.
Les archives de la Fondation en attestent également : l’attention du poète ne s’arrête pas aux paysages conçus comme réceptacles d’un imaginaire, ce sont aussi les hommes qui les peuplent qui suscitent son très vif intérêt. C’est le cas en particulier pour les Indiens (notamment les Navahos), dont les pratiques chamaniques marquent son esprit, jusqu’à constituer un motif essentiel de l’accès à la connaissance telle qu’elle est présentée dans le poème.
« Chère Katherine, voici bientôt un mois que je m’abandonne seul à l’enchantement de cette île sauvage et pourtant privée, où l’affectueuse sollicitude d’une vieille amie de France, Béatrice Chanler, a pu me faire aménager les possibilités d’une véritable retraite. J’emprunte des forces nouvelles, physiques et morales, à ce merveilleux climat du Maine, pour ma reprise d’activité prochaine à Washington. (…) Je n’aurais pas osé rêver d’un isolement pareil à celui de cette île – accru il est vrai du fait de la guerre : fermeture des villas dans toutes les îles du voisinage, désarmement des yachts, enrôlement des pêcheurs, rationnement de l’essence, interdiction de naviguer après certaines heures, etc. Quelle récompense que le mystère recouvré de cette île, maintenant close sur elle-même comme une âme forte et silencieuse et sûre d’elle-même, et dont l’intimité m’est chaque jour une révélation nouvelle. Je mène ici une large vie physique, de défricheur de pistes, de bûcheron, de pilleur d’épaves, de nageur en eau froide, de landscape gardener en imagination, et de naturaliste d’occasion, à demi braconnier, passionnément entomologiste, botaniste, et géologue. Je devrai beaucoup à cette île, où j’ai consommé tant de solitude, et marché, de jour en jour, dans des songes plus riches que je ne jugerais bon aujourd’hui de m’en permettre. Pour explorer tous les bois, toutes les criques et tourbières de cette jungle redevenue vierge, où mon pas inattendu met à peine en fuite bêtes de terre et bêtes de rivage, il me faut parfois cheminer la hachette à la main, comme au beau temps des incursions françaises chez l’Indien. Pour toute compagnie, celle d’un grand chien rouge, setter d’Irlande, dont le regard m’émeut. Pour toutes besognes de ménage, la femme et la belle-sœur du gardien de l’île : deux grandes jeunes femmes étranges, filles d’Indienne Penobscot et de marin danois, qui m’enseignent le nom, l’usage des « simples » du pays. (Elles m’enseignent aussi les rites ancestraux : ne jamais arracher une plante à terre sans lui offrir quelque chose en échange, un peu de tabac si possible. Elles surveillent enfin pour moi toutes les anomalies du ciel nocturne, chargées de m’éveiller aux premiers signes avant-coureurs d’une aurore boréale.) Mes visiteurs du jour : un couple d’orfraies (ospreys), dont je connais le nid dans une petite île inhabitée du voisinage, accessible en « row-boat » ; un grand « héron bleu », familier de mes criques aux heures crépusculaires ; et un vieux phoque solitaire, qu’effraie mon ami chien et qui nous suit à la nage, longeant la grève où nous marchons. Il y a aussi, de bon matin, quelques vieux pêcheurs de « lobsters », mes seuls interlocuteurs, qui me parlent du temps où les « Holy-Rollers » tenaient sur l’île leurs assemblées de convulsionnaires ; où les « élans » du Maine, qu’ils appellent « mooses », gagnaient par mer les îles, avec les cerfs ; où les hivers étaient si froids que sur la mer prise de glace les gens des îles devaient parfois pousser leurs barques sur des traîneaux jusqu’à la côte, vers Camden ou Rockland. Mes autres amis ne sont qu’un peuple de cormorans, de « loons » et de guillemots… »
De même, la composition de Vents est inséparable de ce paysage sauvage et revigorant de Seven Hundred Acre Island, île située sur les côtes du Maine, dans la presqu’île de Penobscot (ci-contre), qu’il côtoie avec vigueur depuis 1942. Il s’agit en fait de l’île privée de Béatrice Chanler, une ancienne connaissance de Leger, rencontrée vers 1920 à Paris (et qui en 1921 l’avait accueilli à Washington, avec Aristide Briand, dont il était le collaborateur). Régulièrement invité chez les Chanler à partir de 1942, voici donc l’un des lieux de prédilection du poète en ces années où ses riches amis américains lui permettent de retrouver cette vie au contact de la nature qu’il affectionne tant (depuis 1941 en effet, échappant à Washington, il séjourne régulièrement chez ses amis, qu’il s’agisse de MacLeish dans le Massachusetts ou des Biddle dans le Connecticut). Seven Hundred Acre Island, cette île si propice aux fortes bourrasques, est le lieu où sera achevé le poème ébauché depuis quelques mois, et il faut se souvenir de l’enthousiasme pour ce décor dont témoigne Leger à Katherine Biddle dans cette lettre du 20 septembre 1942, reproduite dans ses Œuvres complètes :
C’est du reste en cette période clé de la composition de Vents que ce tournant se confirme, venant résoudre une interrogation encore récente chez Leger, sollicité à plusieurs reprises pour un retour à la vie publique (il est par exemple contacté pour occuper le poste de directeur général adjoint de l’UNESCO, qui vient d’être fondé). Les interrogations sont pourtant réelles en la matière, comme en atteste cette lettre à Allen Tate, du 22 août 1946 :
« Pour moi, mes préoccupations sont toujours les mêmes et se font encore plus pressantes au tournant décisif où je me trouve. Il me faut précipiter une décision immédiate entre deux conceptions différentes et définitives : aménagement d’une indépendance littéraire, dont j’espérais trouver la base en Amérique (avec séjour durable dans ce pays et voyage annuel en France), ou réasservissement, en France, à une vie publique, dont je souhaiterais, à mon âge, être affranchi pour toujours. »
Le contrat qui le lie à la Bibliothèque du Congrès doit arriver à expiration en 1946, et même si Vents est écrit dans un contexte de résolution de ce profond dilemme (le poème l’y aide d’ailleurs), c’est bien en 1946 que la nouvelle situation du poète sera stabilisée, par l’obtention d’une bourse allouée par une fondation privée de mécénat littéraire, la « Bollingen Foundation » de New York. Les refus réitérés qu’il oppose aux sollicitations extérieures prouvent en tout cas assez bien qu’il entend en cette période, se consacrer en priorité à son œuvre, comme il a recommencé à le faire depuis 1941 – avec de multiples publications de ses poèmes, à un rythme soutenu.
« Si vivre est tel, qu’on n’en médise ! »
On l’a dit, fussent-ils sertis dans une transposition et une généralisation de sa condition d’exilé, les poèmes d’Exil sont encore imprégnés d’une trace biographique (toujours cryptée, dissimulée, mais que l’on peut néanmoins identifier sous le propos). Vents en revanche, va trancher avec ce ton personnel, pour situer le propos vers l’aventure scripturale et spirituelle d’une vaste fresque humaine en proie au nouveau souffle métaphorisé par ces « grands vents » qui traversent le poème. Mais pour autant, comme pour les quatre premiers poèmes américains, Vents porte le sceau d’un espace propice qui en a favorisé l’éclosion, avant que le poème ne soit abondamment remanié après ses ébauches. Les plages de Long Beach Island ont apporté à « Exil » autant une scène psychologique qu’un théâtre transposable en ce « lieu flagrant et nul » du déracinement ; Savannah a été le réceptacle fertile des « Pluies » rédemptrices que le poème va chanter ; les matins neigeux de New York se retrouvent tout entiers dans « Neiges » ; le Washington du désœuvrement et de la résolution fut le lieu d’origine de ce drame intime qui se joue dans « Poème à l’Etrangère ». On peut le dire, Perse vit intensément les paysages américains, qui fondent désormais en son œuvre comme une profonde empreinte.
Pour la genèse des quatre premiers poèmes américains, voir la synthèse, au sein du séminaire en ligne sur Exil.
En 1945, Leger n’est plus le « proscrit » qui débarquait à New York cinq ans auparavant et dont on retrouve la trace dans « Exil » : il est désormais bien installé dans sa nouvelle condition, et sa situation matérielle un temps précaire, s’est sensiblement améliorée grâce au concours de ses puissants amis américains (essentiellement Katherine et Francis Biddle, ainsi qu’Archibald MacLeish, grâce à qui il occupe depuis 1941 une fonction de conseiller littéraire à la Bibliothèque du Congrès à Washington). C’est surtout là une occasion de renouer, on l’a vu avec le recueil Exil, avec une production poétique qui sera très prolifique à cette époque, et que vient amplifier ce nouveau projet qui voit le jour en cette année de victoire alliée. Le poète a pris le pas sur l’homme public, la dichotomie en ce domaine appartient désormais au passé.
Vents constitue le second grand pan de la production américaine de Perse. Après les quatre poèmes du cycle d’Exil qui ont marqué de 1941 à 1944 le retour à la création pour le poète « restitué à (sa) rive natale », en un déracinement affronté pour ses épreuves et ses conquêtes, avec ses accents biographiques et leur transposition qui parcouraient les poèmes, Vents pourrait représenter un certain « ancrage » américain, si le terme n’était pas inadéquat pour cette poétique à jamais ouverte. Tout se passe comme si après les luttes de l’exil, le poète ouvrait une nouvelle ère de son œuvre, tel qu’en atteste la genèse de ce massif très ambitieux de Vents.